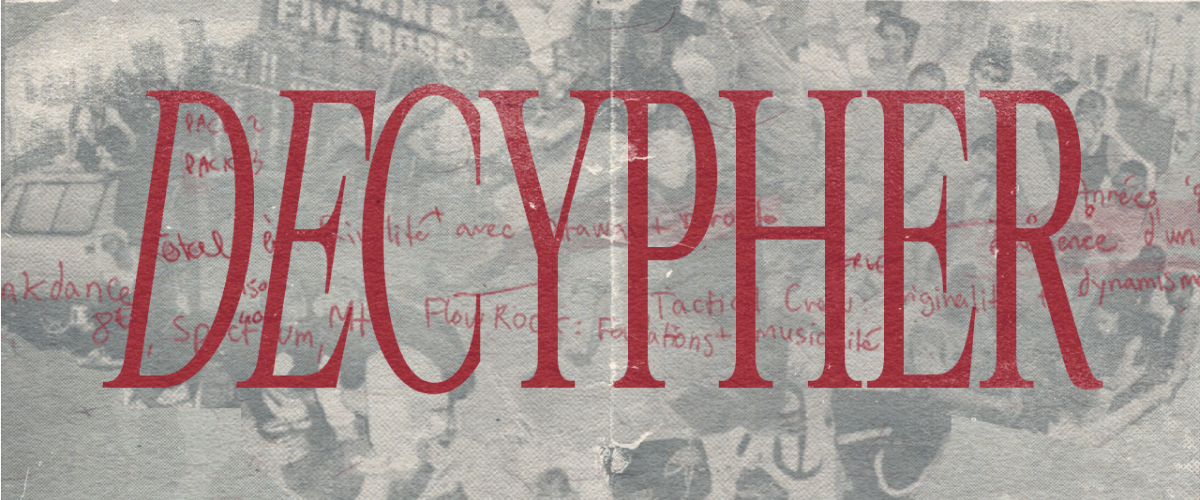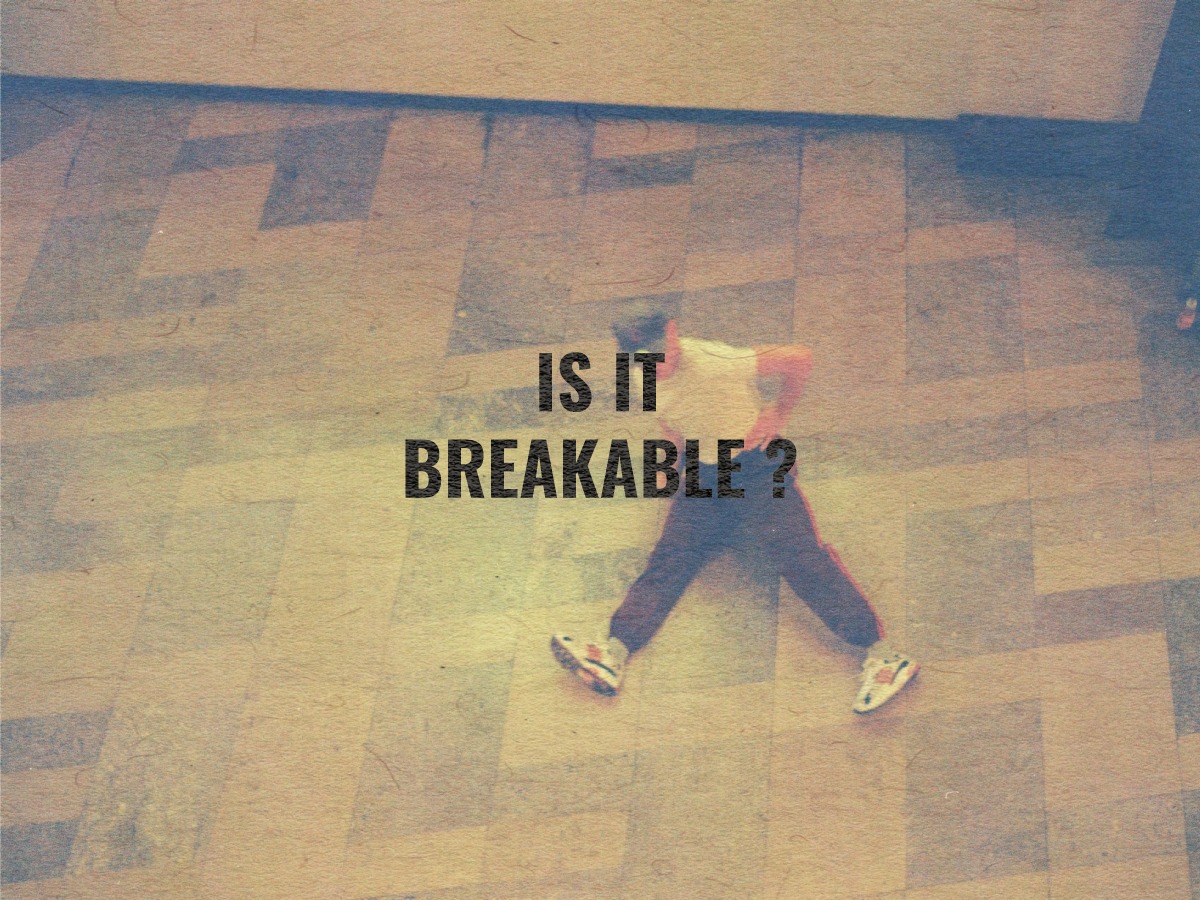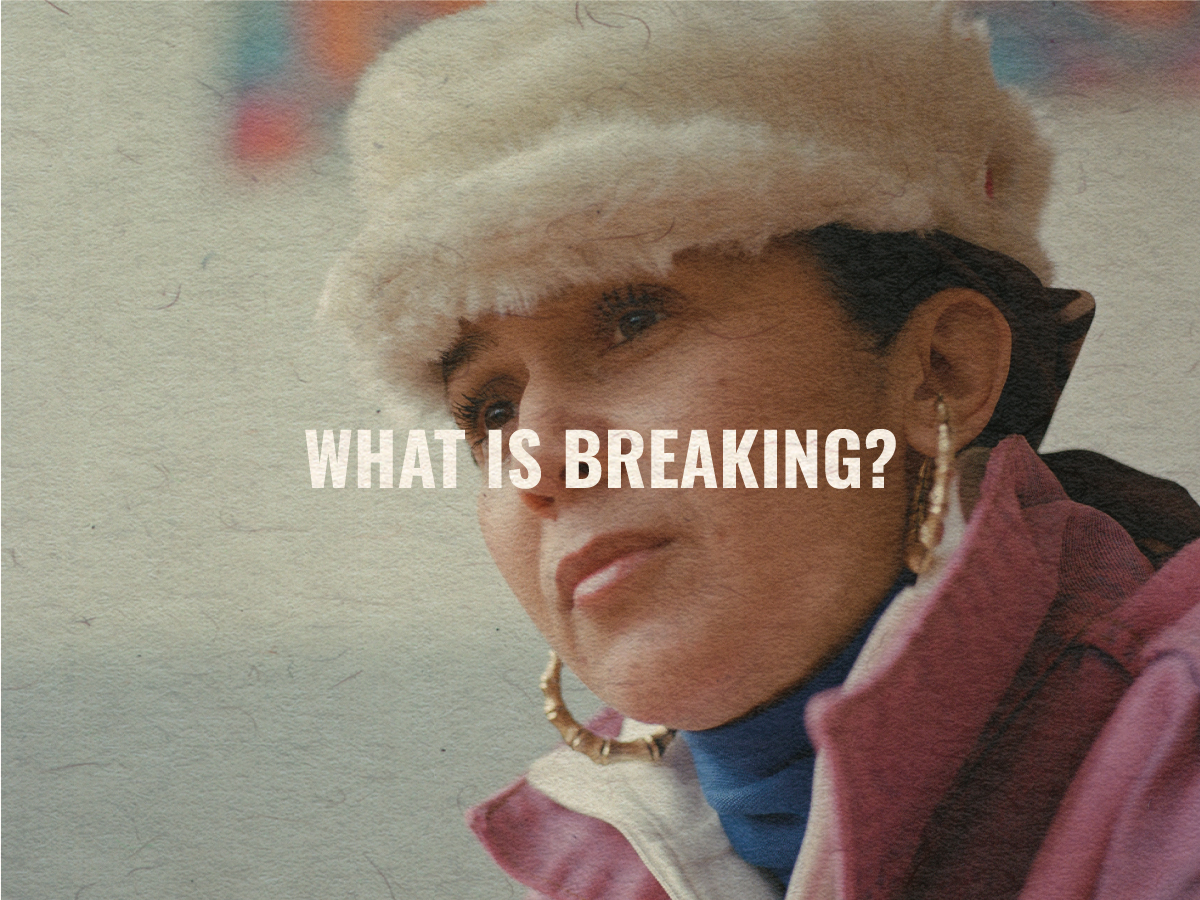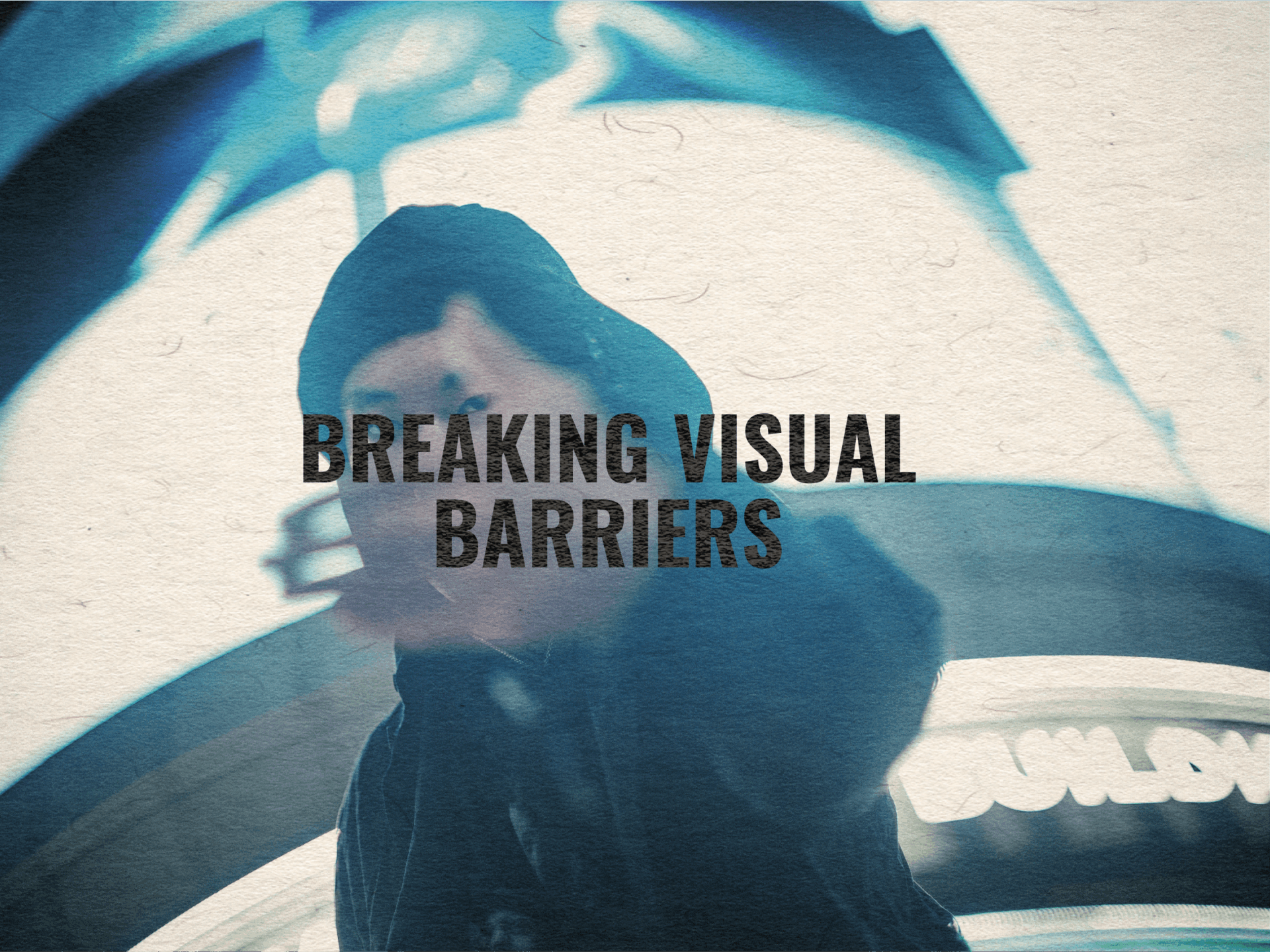Documentaire : Decypher.
Nous avons discuté avec Léo Caron, aka bboy Fléau, pour parler de la sortie du documentaire qu’il a co-réalisé avec Adrian Colina : “Decypher”. “Decypher”, c’est une brève histoire du break montréalais, c’est plus de 50 minutes d’archives jamais vues auparavant, d’interviews, de témoignages des premières générations du break montréalais. “Decypher”, c’est une précieuse partie de l’Histoire résumée et imagée, pour ne pas être oubliée.
Cette entrevue à été réalisée en live sur Instagram. Le live est toujours disponible sur la page de @breakers_magazine.
Je m’appelle Léo Caron. Ça fait maintenant près de 20 ans que je danse. J’ai organisé beaucoup d’événements, le plus reconnu étant le “Skillz-o-meter”. Je danse avec le crew Sweet Technic, accompagné de mes fidèles crewmates, Vicious et Promo. Le dernier de mes projets a donc été la réalisation de ce documentaire. J’avais comme envie d’explorer davantage la danse et son histoire car c’est le sujet duquel je me sens le plus à l’aise, que je maitrise le mieux. Je suis montréalais, je me suis senti à ma place de réaliser ce travail.
BREAKERS : Alors, avant même de parler du documentaire, que nous avons bien sur regardé, on aimerait savoir, qu’est-ce qu’est le « Farine Five Roses » ?
Selon moi, c’est un emblème de Montréal, ça sort du décor. Cette enseigne lumineuse, qui trône au-dessus de cet immeuble désaffecté se dénote, sort du champ de vision et le rend emblématique de Montréal. Ça n’a aucun lien avec le Hip-hop mais ça avait du sens de le montrer régulièrement.
BREAKERS : Donc « Decypher », c’est une brève histoire du break montréalais, du début des années 1980 jusqu’à aujourd’hui. Tu soulignes le mot « brève », car le Canada étant un pays énorme, c’est impossible d’être dans l’exactitude des faits à 100% n’est-ce pas ?
Tout à fait, peu importe la direction que j’aurai pu prendre, j’aurai pu toujours faire autrement, avoir un autre avis sur les histoires que j’aies entendues. J’aurai pu choisir de mettre d’autres éléments en lumière, des éléments plus récents etc. Mais j’ai voulu me baser sur les cassettes VHS que j’ai pu récolter et construire en fonction de ce que je trouvais. J’ai voulu surtout mettre en lumière des images qui n’ont peut-être jamais été diffusées, je voulais aussi ce grain artistique des cassettes VHS.
BREAKERS : Il y a en effet un énorme travail d’archives vidéos dans ce documentaire. Ces archives donnent un vrai rythme, tout s’enchaine bien. J’imagine que je travail de numérisation, de lecture, choix des images a été colossal ?
C’était un travail d’équipe, on a mis beaucoup d’heures là-dessus. Moi, j’arrivais à mettre la main sur les cassettes, et un des mes collègues, un bboy montréalais a tout numérisé très rapidement avec son matériel. Sans lui, tout aurait été plus compliqué, long et cher.


Ensuite, pour choisir les images, ça a aussi été très long. J’ai tout regardé, toutes les cassettes que j’ai reçues. Il fallait être attentif à tous les passages de tous les événements qui étaient bien moins structurés à l’époque. Ça dansait beaucoup plus, avec des échanges moins calculés. Tu as l’impression que plus tu reviens dans le temps, moins il y avait de règles.
J’ai choisi les passages en fonction de ma sensibilité, en me disant que ce qui me parlait allait peut-être parler aux autres.
BREAKERS : Malgré la qualité du documentaire, il y a quelques points sur lesquels on aimerait davantage d’informations. Tu racontes que le Break arrive à Montréal en tout début des années 1980, avec un premier battle – ‘Breakdance 84’ – en 1984. En sais-tu davantage comment c’est arrivé là-bas ? Montréal est relativement plus proche de NY que Paris, et pourtant à Paris c’est arrivé en 1982 avec le New York City Rap Tour. Je suis juste étonné qu’avec la distance, le break ne soit pas arrivé plus massivement, plus tôt.
Je pense que la France est un gros pays du divertissement, avec un monde culturel développé. Dans ce sens, ça ne m’étonne pas que ça soit arrivé rapidement en France malgré la distance. A Montréal, il y a des échanges de connaissance grâce aux gens, aux familles qui voyagent entre NY et Montréal et qui reviennent avec quelques mouvements qu’ils ont observé. Mais c’est très spontané, très éparse, ça ne baigne pas dans un effet de masse donc ça ne favorise pas cette l’émergence de cette culture. Ce reste underground en fait. En 1983, 1984, les premiers films commerciaux ont un impact mondial et apportent une première reconnaissance. C’est peut-être cela qu’attendaient les gens pour sortir un peu de l’undeground. En 1984, il y avait peut-être déjà eu des battles, mais le battle « Breakdance 84 » était le premier battle dans une salle importante, avec des opportunités et des prix pour les vainqueurs.
BREAKERS : Pour t’intéresser à l’histoire de Montréal, tu as un peu du t’intéresser aux histoires des grandes villes voisines. Malgré les longues distances qui séparent les villes canadiennes, y a-t-il eu des évolutions parallèles ?
Comme tu le dis, les distances sont énormes ici. A côté de Montréal il y a Toronto, qui est à 6h de route, et après ça il n’y a rien sans prendre l’avion. Ce n’est pas comme l’Europe ou toutes les villes sont proches, avec leurs propres cultures etc. Donc dans ce sens, ça ne s’est pas développé de la même manière. Cependant, Toronto a longtemps dominé la scène canadienne. De nombreux groupes de Toronto ont réussi à se démarquer internationalement : Bag of Trix, Boogie Brats… Mais je ne peux pas trop en dire davantage, je me suis vraiment concentré sur Montréal pour ce documentaire.




BREAKERS : Pendant la réalisation du documentaire, tu as du faire un choix sur les histoires que les intervenants t’ont partagées. Est-ce que tu aurais une petite anecdote, qui aurait façonnée le break montréalais d’une certaine manière, qui n’est pas dans le documentaire à nous partager ?
Je n’en ai pas vraiment qui me viennent à l’esprit, malgré le fait qu’on m’en a raconté ! Celle que je peux préciser est celle qui est dans le documentaire : c’est le fait que des groupes rivaux, qui avaient des approches opposées les ont valorisées et que ça a eu un grand impact sur le break montréalais. Cette constante rivalité entre ces 2 crews a permis au bboy montréalais moyen d’être inspiré par 2 écoles différentes et lui a permis de devenir complet et créatif. Ces 2 notions de complétion et de créativité ont rapidement été assimilées par la scène montréalaise. Encore aujourd’hui, dans l’approche générale du break, ce sont des aspects qui perdurent alors qu’ailleurs, un aspect sportif pourrait prendre le dessus.
BREAKERS : C’est l’héritage qu’ont laissé les premières générations ?
Oui, on n’a même pas besoin de l’enseigner. On invite les nouvelles générations à observer, à suivre cette vibe qu’ils voient et à s’y intégrer. Tout le monde vibre de ça, donc tu n’as pas le choix que de t’y fondre. La fête est liée à la danse.
BREAKERS : Le Canada a une histoire tristement célèbre avec les amérindiens natifs, les populations autochtones, les réserves etc. Cette communauté, qui a beaucoup souffert a apporté sa part du gâteau à la création du Hip-hop dans les quartiers New-Yorkais, notamment avec le rocking, le mouvement « bow-and-arrow » etc. Est-ce que ces peuples se sont manifestés dans la naissance du Hip-hop à Montréal ?
Je connais du monde de la scène de break des alentours de Montréal qui sont des membres des premières nations, ou qui travaillent dans les réserves. Des gens aussi qui sont allés dans les réserves, dans le Grand Nord pour y emmener le Hip-hop, faire du travail social, de l’insertion, de l’aide à la jeunesse. Notamment à Ottawa, un bboy, un OG avait mené le projet « BluePrint for life ».
A Montréal même, c’est sûr qu’il doit y avoir une influence, mais je n’ai pas ressenti cela dans la réalisation du documentaire. La plupart des personnes des premières nations à Montréal sont dans des situations sociales très compliquées car ils n’ont peut-être pas été accompagnés lorsqu’ils ont quitté les réserves. Peut-être que les autres luttes importantes auxquelles ils devaient faire face a fait qu’ils n’ont pas pu s’impliquer dans la culture Hip-hop.
BREAKERS : Dans le documentaire, on voit que l’aspect du « crew », le fait de « danser pour ses gars » est omniprésent. Est-ce que ca se perd aussi au Canada ?
Oui, mais comme partout, on a l’aspect sportif qui est mis en avant. Les compétitions solo deviennent plus populaires. Le côté crew est plus rare. Malgré des acteurs qui continuent de vraiment valoriser ça, tu vois de plus en plus de super crews, des teams. Aussi, je pense que avant le break était plus populaire. Dans les années 80-90, il y avait pleins de danseurs, ça attirait beaucoup de monde donc c’était peut-être plus facile de se trouver un crew. Maintenant, c’est plus individualisé, comme tout. Ca redevient populaire, mais différemment.
Le break est hyper gros dans certains pays, avec les fédérations et tout, mais est-ce que ça en est populaire pour autant ?
BREAKERS : Ca fait le pont parfaitement avec la prochaine question que je veux te poser. Est-ce que tu trouves que le Break est cool ? Que c’est stylé ?
Honnêtement, non. Mais j’aime ce qui n’est pas cool !
[…] Découvrez la fin de l’interview sur le live instagram !


Légende :
1. Le groupe New Energy après sa victoire à la 1ère compétition officielle de Break à Montréal : Breakdance 84
2. Le groupe Tactical Crew, Montréal, fin 90.
3. Cercle de Break lors de l’événement Gravity Rock à Montréal, fin 90.
4. Bboy Shadow Kid, Montréal, début 2000.
5. New Energy pendant un spectacle, début 80, Montréal.
6. Le groupe Da Lunatic Breakaz, Montréal, fin 90.
7. Le groupe Flow Rock, Montréal, fin 90.
SI VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE, VOUS DEVRIEZ CONSIDÉRER DE VOUS OFFRIR NOS MAGAZINES
SUGGESTIONS